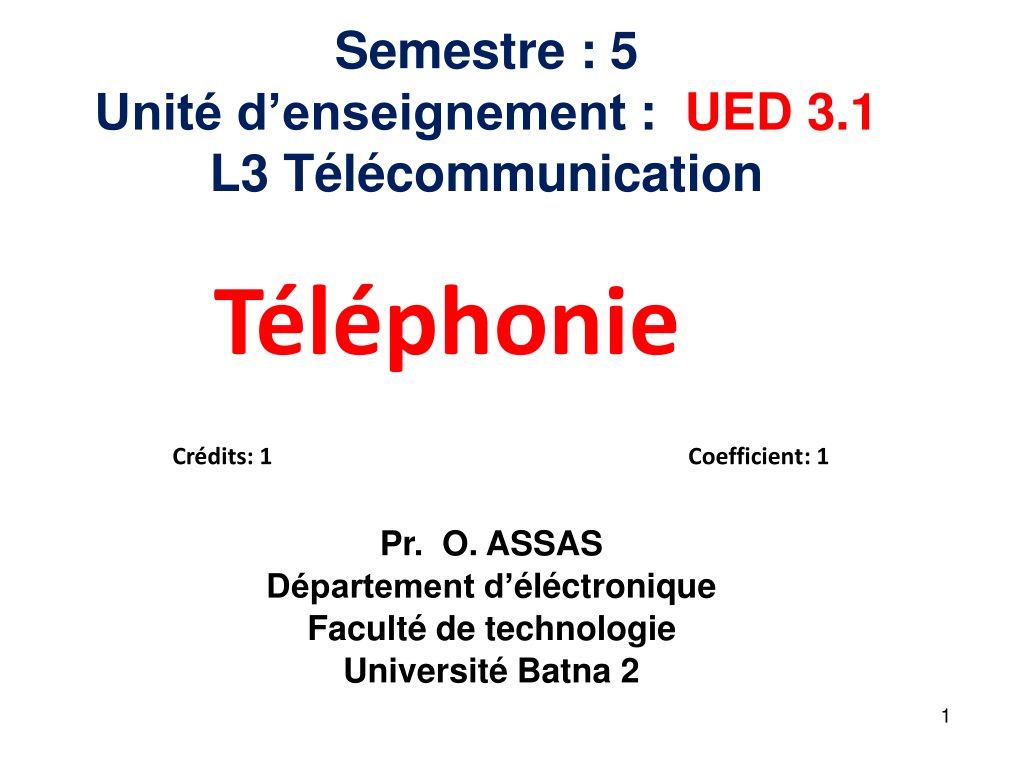
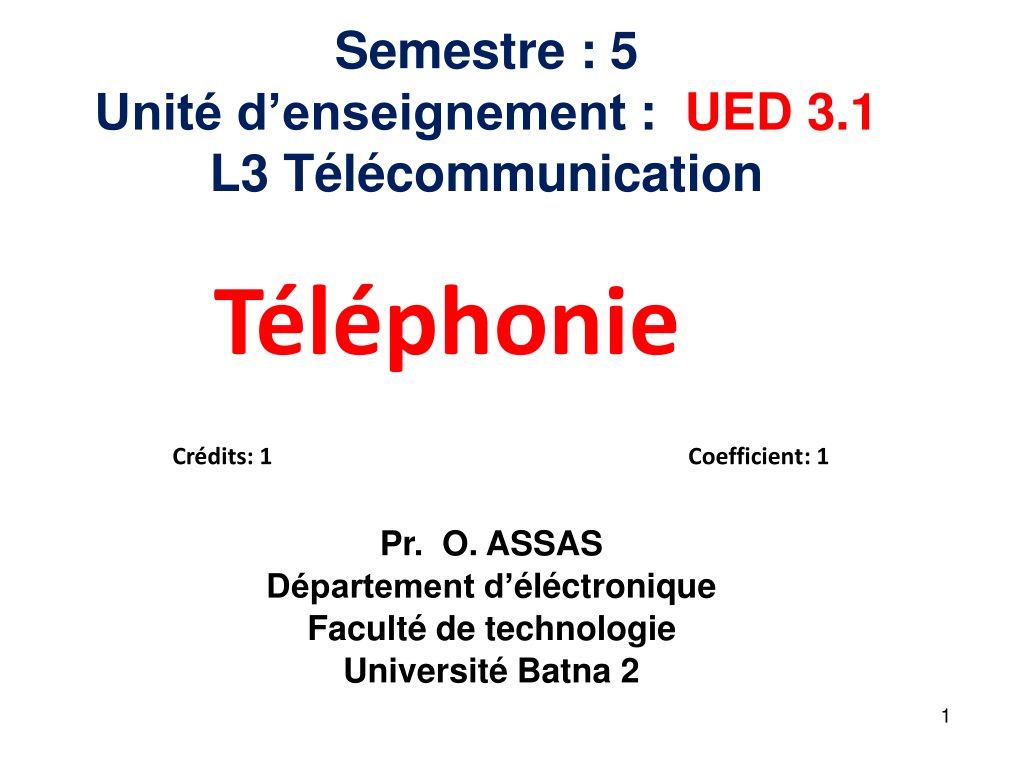
0 likes | 5 Views
Explore the evolution and future of telephony as a crucial aspect of communication networks. Topics include historical background, principles, architectures, and technologies in telephony. Learn about analog and digital transmission, cellular networks, and equipment used in telephony. Dive into the latest generations of digital telephony and network interconnection equipment. Recommended prerequisites include knowledge of analog communication and basic understanding of telecommunications applications.

E N D
Semestre : 5 Unité d’enseignement : UED 3.1 L3 Télécommunication Téléphonie Crédits: 1 Coefficient: 1 Pr. O. ASSAS Département d’éléctronique Faculté de technologie Université Batna 2 1
Objectifs de Cours Les réseaux de communications englobent un large domaine d’applications. La téléphonie, en particulier, reflète bien l’un des réseaux de communication les plus utilisés dans la société d’aujourd’hui. Son évolution, ses caractéristiques et son futur sont d’une importance cruciale pour les étudiants qui se spécialisent télécommunications numériques. fonctionnement, son dans les 2
Connaissances préalables recommandées La communication analogique. Les applications des télécommunications. 3
Contenu de cours Chapitre 1. La commutation : Historique, évolution, principe et architecture Chapitre 2. Supports téléphonie : Critères d’évaluation, Sans fil, Fibre optique Chapitre 3. La cellulaire GSM : Réseaux, Protocoles, Architecture et équipements, Schémas de principe, Mesures. téléphonie analogique à de transmission en Conducteurs électriques, téléphonie numérique 4
Contenu de cours Chapitre 4. Les nouvelles générations de la téléphonie numérique : 3G et UMTS, 3.5 G, 4G, … Chapitre 5. Equipements d’interconnexion en téléphonie : Les commutateurs, les routeurs, les interfaces, les passerelles 5
Mode d’évaluation Examen : 100% 6
Références bibliographiques 1. C. Servin ; Réseaux et Télécoms ; Dunod, 2006. 2. G. Pujolle, Cours réseaux et télécoms : Avec exercices corrigés, 3eédition ; Eyrolles, 2008 3. R. L. Freeman ; Telecommunication System Engineering ; John Wiley & Sons, 2004. 4. D. Smith, J. Dunlop ; Telecommunications Engineering ; CRC Press 3rd Edition 1994. 5. J.C. Bellamy ; Digital Telephony ; John WileY & Sons, INC, 2000. 6. K. Poupée, La Téléphonie mobile ; Collection Que sais-je ? PUF, 2003. 7
Références bibliographiques 7. L. Ouakil, G. Pujolle, Téléphonie sur IP, 2eédition, 2008. 8. H. Holma, A. Toskala; UMTS: Les réseaux mobiles de troisième generation 2e édition, 2001. 9. L. Merdrignac ; Terminaux téléphoniques ; Techniques de l’ingénieur, 1990. 10.J. Pons ; Voix sur IP : Internet, fixe et mobile - Principales normes, Techniques de l’ingénieur, 2009. 11.J. Cellmer ; Réseaux cellulaires, Du système GSM au système GPRS ; Techniques de l’ingénieur, 2004. 8
Chapitre 1. La téléphonie analogique à commutation
Plan du cours Introduction Historique évolution Réseau téléphonique commuté (RTC) Organisation du Réseau téléphonique (architecture et gestion) Communication téléphonique 1 0
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation INTRODUCTION: Dans les années 1830, François Sudre avait donné le nom Téléphonie à son système de transmission de sons à distance, basé sur les notes de musique, pour l’échange de messages. 11
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation INTRODUCTION: La téléphonie est devenue ensuite un système de communication essentiellement la reproduction de la parole (et plus rarement d'autres signaux sonores), système qui regroupe un ensemble de fonctionnalités téléphoniques. assurant et transmission la 12
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation DEFINITION: La téléphonie est un groupe de systèmes de communications qui a pour objectif principal d’assurer la transmission et la reproduction du son à distance. 13
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation DEFINITION: Télécommunication La télécommunication est la transmission à distance d’informations avec des moyens technologiques différents. Préfix grec «télé» = loin Latin « communicare» = partager La Téléphonie est un domaine de la Télécommunication 14
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation DEFINITION: Le téléphone communication initialement conçu pour transmettre la voix humaine et permettre une conversation à distance. est un appareil de 15
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Historique 1876 : Mise au point du premier téléphone par Alexander Graham Bell, 1878 apparition du commutateur téléphonique manuel, qui peut être considéré comme l’ancêtre de nos centraux téléphoniques actuels, était mis en service à New Haven. 1906 : La première Conférence radiotélégraphique internationale est organisée à Berlin. Elle aboutit à la signature de la première Convention radiotélégraphique internationale pour réglementer télégraphie sans fil. notamment 16 la
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation : Historique 1924 : Création à Paris du C.C.I.F. (Comité Consultatif International des liaisons téléphoniques à grandes distances) qui sera rattaché internationale des télécommunications) en 1925. 1956 : Création du CCITT à Genève (Comité consultatif international télégraphique et téléphonique), 1970 : Premiers commutateurs (commutation temporelle), à l’U.T.I. (l'Union numériques 17
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation : Historique 1976 : Signalisation par canal sémaphore (Moyen de transmission utilisé pour transporter des messages de signalisation indépendamment des voies) (Comité consultatif international télégraphique et téléphonique : CCITT n°7). 1980 : Etude du numérique de bout en bout, 1980 : Le clavier à touches remplace le traditionnel cadran, pour faciliter la composition des numéros 1985 : Synchronisation du réseau (horloges atomiques), n° à 8 chiffres, 18
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation 1990 : Innovation Majeure: Les combinés n’ont plus besoin d’être reliés à un poste par un fil, les communications étant désormais transmises par ondes radio entre le combiné et le poste (exemple: Cordless Téléphone Génération 0) 19
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation 2000 : Le téléphone portable, dit « mobile » fait son apparition et attire le milieu professionnel avant de séduire le grand public. 2007-2008: L’avènement des smartphones est marqué par la sortie de l’iPhone en 2007 et des premiers téléphones Android en 2008. 20
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Evolution du réseau téléphonique Première génération: RTC entièrement analogique transport de la voix en temps réel. Deuxième génération : Réseaux numériques utilisant toujours la commutation de circuits Troisième génération: Téléphone sur IP les infos dans des paquets émis sur lal’opérateur.. Après les années 90s, une nouvelLE téléphonie cellulaire mobile (GSM, UMTS...etc.), 21
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation : Innovations Majeures 1877: Invention du 1ER téléphone (Graham Bell) 1973: Première ère de mobiles modernes 1980: Téléphone avec clavier a touches 1981: Premier réseau de phone cellulaire 1983: Internet 1990: Téléphone sans fils (Cordless Telephone) 1998: Téléphone Satellite 2003: Technologie d’internet Voice over IP (VOIP) 2008: Google Glass 2010: 4G A-LTE 2020: 5G et internet des objets 22
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Le réseau téléphonique commuté (RTC) 23
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Le réseau téléphonique commuté (RTC) Les équipements téléphoniques sont conçus pour assurer les relations de télécommunications, soit : • en empruntant les lignes du réseau public RTC, ce sont des communications extérieures. • soit au sein d’une même entreprise, il s’agit alors de communications internes autocommutateur privé. L’accès au réseau public se fait alors en composant un préfixe supplémentaire. traitées par un 24
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Le RTC est composé (commutateurs) informations au moyen de protocoles de communications Chaque poste téléphonique est rattaché à une seule borne de répartition connectée à un commutateur local (local switch) dont la distance peut aller de quelques centaines de mètres jusqu’à quelques kilomètres, la distance réduisant d’autant la bande passante des signaux transitant. de noeuds s’échangeant des 25
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Organisation Du Réseau: Téléphonique : Architecture 26
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Organisation Du Réseau: Téléphonique : Architecture Le organisation niveaux (Figure1.3). Il est structuré en zones, chaque zone correspond à un niveau de concentration et en principe de taxation. On distingue réseau téléphonique hiérarchique a une trois à 27
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Organisation Du Réseau: Téléphonique : Architecture Zone à Autonomie d’Acheminement (ZAA), cette zone, la plus basse de la hiérarchie, comporte un ou plusieurs Commutateurs à Autonomie d’Acheminement (CAA) qui eux- mêmes desservent des Commutateurs Locaux (CL). Les commutateurs locaux ne sont que de simples concentrateurs de lignes auxquels sont raccordés les abonnés finaux. La ZAA (Zone à Autonomie d’Acheminement) étoilé, elle constitue le réseau de desserte ; est un réseau 28
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Organisation Du Réseau: Téléphonique : Architecture – Zone de Transit Secondaire (ZTS), cette zone comporte des Commutateurs de Transit Secondaires (CTS). Il n’y a pas d’abonnés reliés directement aux CTS (Commutateurs de Transit Secondaires). imparfaitement Secondaires). Le réseau étant imparfaitement maillé (Commutateur à Autonomie d’Acheminement) ne peut atteindre directement le CAA destinataire, ils assurent le brassage des circuits. Le réseau étant lorsqu’un CAA 29
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Organisation Du Réseau: Téléphonique : Architecture – Zone de Transit Principal (ZTP), cette zone assure la commutation des liaisons longues distances. Chaque ZTP (Zone de Transit Principal) comprend un Commutateur de Transit Principal (CTP). Au moins un Commutateur de Transit Principal (CTP est relié à un Commutateur de Transit International (CTI). 30
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Organisation Du Réseau: Téléphonique : Architecture Remarque Le réseau étant partiellement maillé, plusieurs itinéraires sont généralement possibles pour atteindre un abonné. 31
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Gestion du réseau Gestion du réseau – La distribution. – La commutation. – La transmission. 32
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation – La distribution: comprend essentiellement la liaison d’abonné ou boucle locale (paire métallique) qui relie l’installation de l’abonné au centre de transmission de rattachement. Cette ligne assure la transmission de la voix (fréquence vocale de 300 à 3 400 Hz), de la numérotation (10 Hz pour la numérotation décimale – au cadran – et 697 à 1 633 Hz pour la numérotation fréquentielle) et de la signalisation numérotation fréquentielle) et de la signalisation générale (boucle de courant, fréquences vocales); 33
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation –La commutation: c’est la fonction essentielle du réseau, elle consiste à mettre en relation deux abonnés, maintenir la liaison pendant tout l’échange et libérer les ressources à la fin de celui-ci. C’est le réseau qui détermine le celui-ci. C’est le réseau qui détermine les paramètres de taxation et impute le coût de la communication à l’appelant ou à l’appelé. 34
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation – La transmission: c’est la partie support de transmission du réseau, cette fonction est remplie soit par un système filaire cuivre, par de la fibre optique ou par des faisceaux hertziens. Aujourd’hui, les réseaux sont intégralement numérisés, d’abonné est encore, la plupart du temps, analogique et sur support cuivre, notamment pour les abonnés résidentiels. seule la liaison 35
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation La communication téléphonique. Établir une communication téléphonique c’est mettre en relation téléphoniques. deux terminaux 36
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation La communication téléphonique. Au repos, le téléphone est soumis à une tension continue d’environ 48 V (figure.1.6) résultant de la télé-alimentation venant du central, qui sert à alimenter le téléphone, détecter le décrochage et l’activité de numérotation. (i < 3 mA) 37
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Phase 1 – Décrochage 38
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation La communication téléphonique. Phase 2 – Tonalité 39
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation La communication téléphonique. Phase 3 – Numérotation E.164 recommendation, "international public telecommunications numbering plan," publier par ITU-T onMay 1997. 40
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation La communication téléphonique. Phase 3 – Numérotation 41
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation La communication téléphonique. Phase 3 – Numérotation 42
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation La communication téléphonique. Phase 3 – Numérotation décimale 43
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation La communication téléphonique. Phase 3 – Numérotation par fréquence 44
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Phase 3 – Numérotation par fréquence Dans le cas de l’appui sur le clavier de la touche «8», le numéroteur transmet une tension composée d’un signal de 852Hz et d’un signal 1336Hz 45
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation La communication téléphonique. Phase 3 – Numérotation par fréquence Numérotation par fréquences vocales ou DTMF Le DTMF (Dual Tone Multi Frequency).Il doit émettre deux fréquences spécifiques dans la gamme 300Hz - 3400Hz pour transmettre un chiffre.Il est très peu probable que deux fréquences dont les valeurs sont premières entre elles, soient présentes à l’arrière plan du microphone pendant la numérotation. normalisées au plan international (norme UIT-T-Q.23). Ces fréquences sont 46
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation La communication téléphonique. Phase 3 – Numérotation par fréquence Numérotation par fréquences vocales ou DTMF Le DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Il doit émettre deux fréquences spécifiques dans la gamme 300Hz - 3400Hz pour transmettre un chiffre. Il est très peu probable que deux fréquences dont les valeurs sont premières entre elles, soient présentes à l’arrière plan du microphone pendant la numérotation. Ces fréquences sont normalisées au plan international (norme UIT-T-Q.23). 47
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Phase 4 – Activation de la Sonnerie 48
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Pour activer la sonnerie, le central envoie vers le poste (B) un signal sinusoïdal de fréquence environ 50 Hz par rafales, activé pendant environ 2 secondes et désactivé pendant environ 4 secondes. Ce signal est superposé à la tension continue de 48V. Le décrochement du poste B établit un courant continu d’environ 40mA dans la ligne. Le central RTC supprime la sonnerie et met en liaison les deux correspondants. Lorsque la liaison est établie, on a pratiquement une ligne point à point. 49
Chapitre 1: La téléphonie analogique à commutation Phase 4 – Activation de la Sonnerie